Toponymie
Vindunum
La ville est attestée dès le IIe siècle av. J.-C. sous la forme Vindinon. À l'époque gallo-romaine, le nom de Vindunum est mentionné par le géographe Ptolémée.
Le toponyme primitif Vindinon est d'origine celtique (gaulois). Il est en effet composé des éléments Vindo- (« blanc ») et peut-être de dunon « citadelle, enceinte fortifiée, mont », à moins qu’il ne s’agisse que du suffixe -ino- attesté dans la toponymie gauloise (cf. Caracotinum ou Barentinum), d'où le sens global de « citadelle blanche » ou plus simplement « la Blanche ».
Le Mans
La ville prend au IVe siècle le nom du peuple gaulois des Aulerques Cénomans, dont elle était le chef-lieu, la Civitas Cenomanorum. De nombreuses autres cités gallo-romaines ont connu un changement de nom similaire à cette époque, notamment Lutèce qui est devenue Paris (cité des Parisii). La ville est mentionnée comme Ceromannos au Ve siècle, Ceromannis au VIe siècle, réduit à *Celmans, forme déduite d’après la mention in pago Celmannico en 765. On trouve aussi des formes du type Clemanes dans la Vita de saint Maximin au (VIIe siècle), puis « Hlemanes » au IXe siècle, enfin Lemanes. La première mention en tant que Mans date du XIIe siècle, dans le Roman de Rou ; Prez del Mans. Une charte de 1264 réserve même toute une partie à la cité avec son Chapitre dou Mans. Le remplacement de la syllabe ce- par l'article « le » a eu lieu au XIIe siècle, lorsque ce- a été assimilé à l'adjectif démonstratif « ce ».
Le peuple des Cénomans a aussi donné son nom au Maine, la province dont Le Mans était capitale. Les peuples gaulois sont d'ailleurs souvent à l'origine du nom d'une ville et de sa province. Cela est notamment vrai pour Angers et l'Anjou, Tours et la Touraine, Saintes et la Saintonge, Poitiers et le Poitou, Rodez et le Rouergue, Bourges et le Berry ou encore Limoges et le Limousin.
L'ancienne prononciation du nom de la ville est connue grâce à Jacques Peletier du Mans, entre autres, qui signalait au XVIe siècle (dans une orthographe personnelle qu'il essayait de diffuser) : « Vrèi et qu'en Normandie, é ancous en Bretagne, an Anjou, é an votre Meine… iz prononcet l'a devant n un peu bien grossement é quasi comme s'il i avoèt aun par diftongue ; quand iz diset Normaund, Aungers, le Mauns, graund chose. » La graphie le Mauns reflète la diphtongaison du [a] nasalisé. La diphtongue nasale est typique de l'ouest de la France et se retrouve toujours dans les langues d'oïl de ces régions.
Les monuments historiques du Mans.
Trop nombreux pour les citer tous ici !!!
Monuments romains
L'enceinte gallo-romaine
La vieille ville est ceinturée d'une enceinte gallo-romaine polychrome construite à la fin du IIIe siècle, encore très bien conservée. Elle constitue le plus important témoignage de l'architecture militaire du Bas-Empire en France, c'est l'édifice le mieux conservé d'Europe, après la ville de Rome.

Les thermes de Vindunum
Les thermes de Vindunum se trouvent sous l'école des Beaux-arts du Mans, au sud-ouest du mur d'enceinte.
Monuments du Moyen Âge
La Cité Plantagenêt
La cité Plantagenêt est le cœur de la ville médiévale du Mans situé à l'intérieur de la muraille et appelé aussi « Vieux Mans ». La plupart des maisons datent de la Renaissance. On peut citer notamment la maison d'Adam et Ève, les hôtels de Clairaulnay et de Vaux.

La cathédrale Saint-Julien
La cathédrale Saint-Julien combine l'art roman — pour la nef — et l'art gothique — pour le chœur et l'abside. Elle possède un chevet gothique, haut de 33 mètres. Elle a été construite entre le XIe et le XVe siècle.

Les abbayes
Au sortir du Moyen Âge, la ville s'est dotée de plusieurs abbayes et cloîtres. Parmi ceux toujours visibles aujourd'hui, on peut noter l'abbaye Saint-Vincent, construite en 572. L'édifice est aujourd'hui intégré au lycée Bellevue.
L'abbaye de l'Épau est une ancienne abbaye cistercienne fondée par la reine Bérengère de Navarre en l'an 1229. Le gisant de la reine Bérengère se trouve au sein de l’église abbatiale.
L'église de la Couture est l'ancienne abbatiale de l'abbaye Saint-Pierre de la Couture.

La collégiale Saint-Pierre-la-Cour
La collégiale Saint-Pierre-la-Cour est d'abord une église édifiée intra muros au Xe siècle, à la suite des invasions normandes du IXe siècle. Elle est rebâtie par Henri II Plantagenêt en 1175 avant qu'elle ne soit de nouveau agrandie en 1267 avec le soutien de Charles III d'Anjou.

La Maison du Pilier RougeLa Maison du Pilier Rouge est construite durant le XVe siècle. Les poteaux qui la soutiennent ont été implantés sur un sol de pierre, fait pour l'occasion. Cela permettait de les protéger de l'humidité.

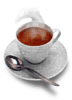
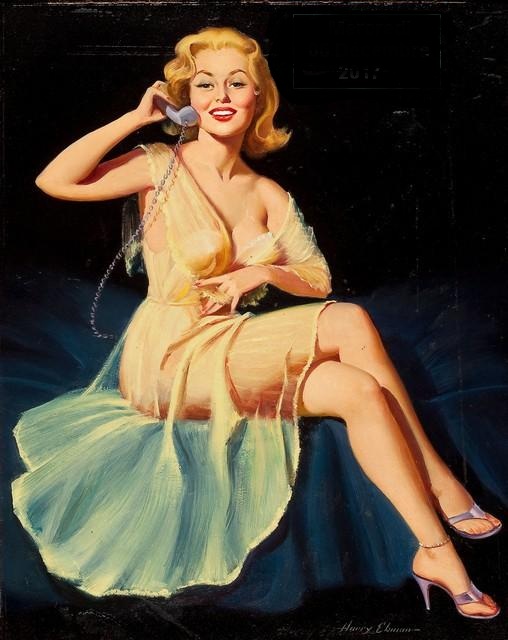
































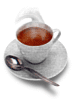
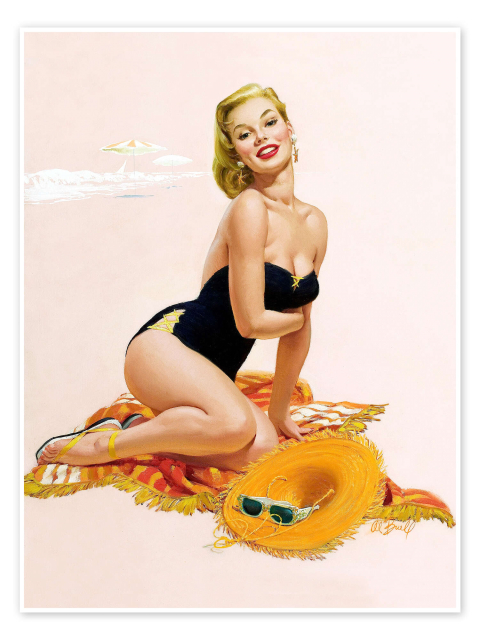







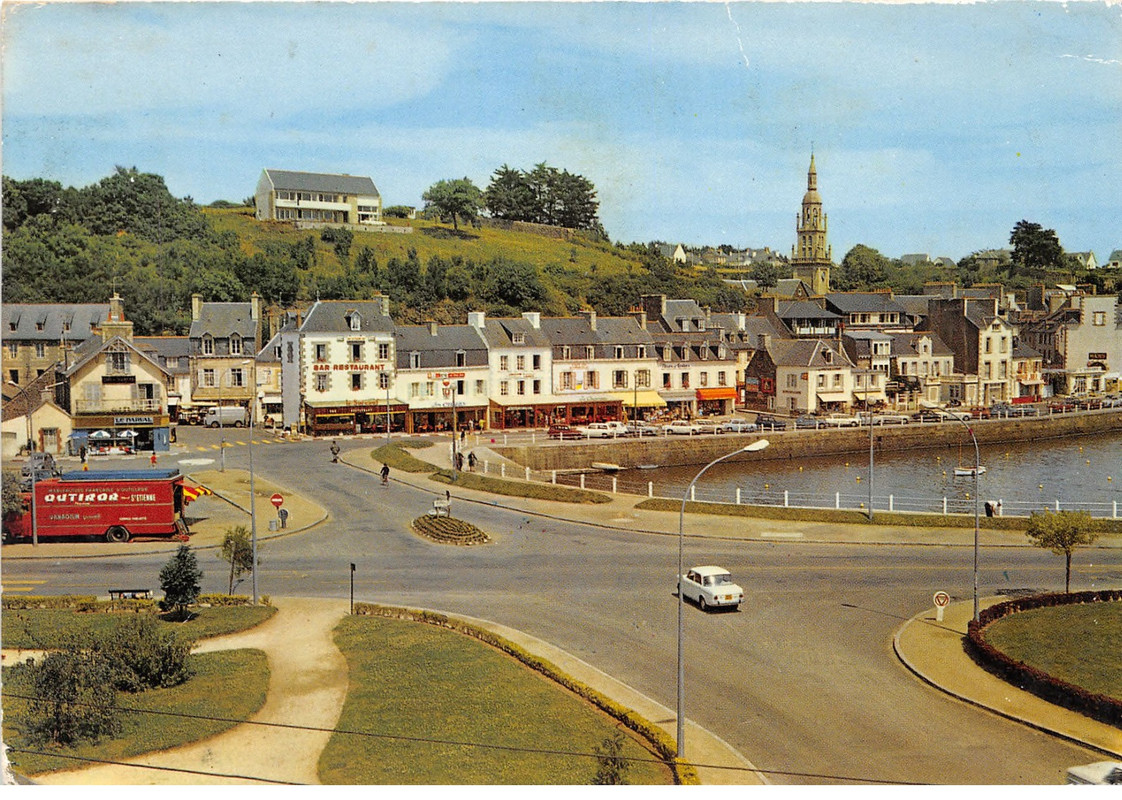



 _____
_____ _____
_____


 _____
_____ _____
_____







